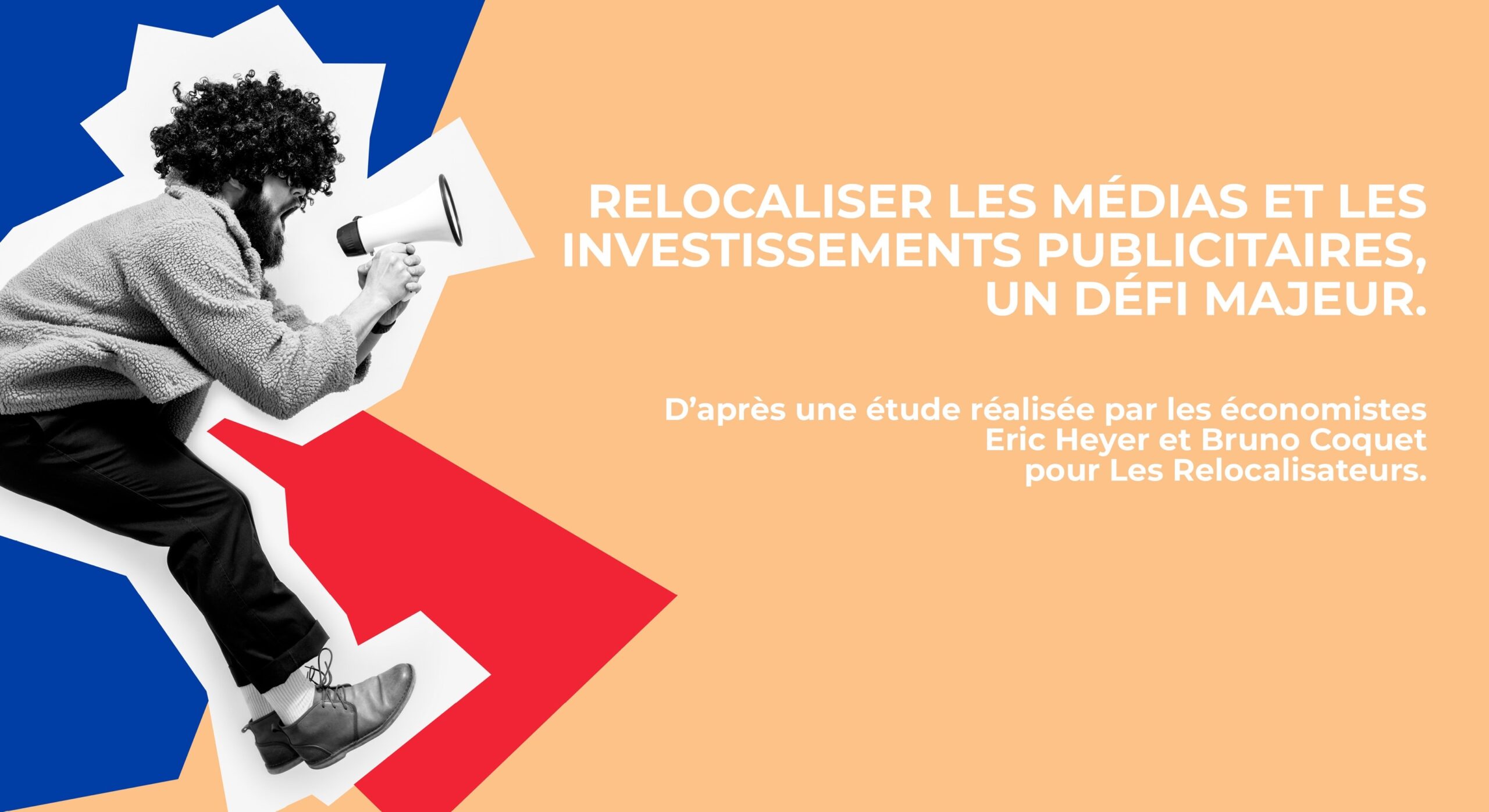Relocaliser les médias et les investissements publicitaires, un défi majeur.
D’après une étude « Relocaliser les investissements publicitaires » réalisée par les économistes Eric Heyer et Bruno Coquet pour les Relocalisateurs*.
Depuis deux décennies, le marché de la publicité a amorcé une mutation inédite. L’essor du digital a profondément bouleversé l’équilibre : aujourd’hui plus de 75% des budgets publicitaires sont captés par les géants du numérique, au détriment des formats plus classiques (TV, radio, print). Le modèle économique de nos médias dits « traditionnels » en est fortement menacé.
Mais alors, quel est leur avenir ? Cette domination est-elle une fatalité ? Une relocalisation des médias peut-elle inverser cette tendance et favoriser leur croissance, l’emploi et leur vitalité ?
La publicité digitale, une montée en puissance.
Depuis le début des années 2000, l’émergence du digital coïncide avec une contraction historique des recettes publicitaires pour les médias traditionnels. Aujourd’hui, trois acteurs (Alphabet, Meta et Amazon) concentrent une part écrasante du marché et captent à eux seuls 75% des investissements publicitaires, un montant comparable au PIB du Danemark. Leur succès fulgurant est dû à la qualité de leur technologie et des services qu’ils proposent : ils attirent une forte audience qui, à son tour, attire les annonceurs en recherche d’ultra ciblage publicitaire.
Mais ce n’est pas la seule raison de la position dominante des Géants du Numérique : distorsions de concurrence et optimisation fiscale sont des piliers essentiels de leur modèle économique.
Et, malgré leur chiffre d’affaires élevé, on remarque que les Géants du Numérique emploient peu et que leurs performances ne bénéficient que très peu à l’économie de notre pays.
C’est donc un véritable oligopole sur le marché publicitaire qui se construit à grande vitesse et qui, en l’absence de sursaut, en fixera bientôt seul les règles et les prix, sans aucun contre-pouvoir possible.
Quelles conséquences pour nos médias ?
Pour les médias traditionnels, le choc est rude : avec la baisse des revenus publicitaires, la diminution de leur nombre et de leur diversité va s’accroître. En France, la part du digital dans les investissements publicitaires dépasse déjà 50 % et pourrait atteindre 65 % d’ici 2030. Contrairement à d’autres marchés où le digital a entraîné une augmentation globale des investissements, la France n’a pas bénéficié d’un effet d’offre : les revenus publicitaires ont stagné, voire reculé, affaiblissant les médias locaux. A titre d’exemple, on observe qu’un tiers des titres de presse ont disparu depuis 2005 aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, plus de 320 titres locaux ont fermé entre 2009 et 2019, les recettes publicitaires ayant chuté d’environ 70 %.
C’est donc le débat public qui en souffre avec des conséquences directes sur nos démocraties. Ainsi, une étude du MEDILL montre que le niveau de la participation électorale aux Etats-Unis a chuté dans les territoires les plus touchés par le phénomène de désertification médiatique, où il ne reste plus ou qu’un seul journal local. De fait, la fiabilité des informations disponibles risque de décroitre comme le met en lumière le récent désengagement de X puis de Méta de leur responsabilité de vérification et de modération des informations qu’ils diffusent massivement. La prolifération des vagues de « fake news » pourrait devenir le quotidien de ces plateformes, déstabilisant ainsi la vie démocratique.
Vers une relocalisation des médias ?
Face à cette situation préoccupante, l’étude propose plusieurs scénarios pour redynamiser le marché publicitaire français et endiguer ce phénomène de captation des ressources. Une meilleure régulation de la fiscalité et une redistribution plus équilibrée des investissements pourraient générer des bénéfices macroéconomiques significatifs. À titre d’exemple, une reconquête de 1 milliard d’euros de recettes publicitaires par les médias historiques pourrait accroître le PIB de 760 millions d’euros et créer 12 400 emplois, dont les deux tiers directement dans la branche publicité.
Toutefois, la relocalisation des investissements publicitaires ne peut être envisagée sans une action concertée des pouvoirs publics, des annonceurs et des médias. Des leviers tels que la régulation des pratiques fiscales des GN, l’incitation à l’investissement local ou encore le soutien aux régies publicitaires françaises pourraient permettre de rééquilibrer le marché. Mais il faut agir très vite sans quoi les dégâts seront irréversibles pour nos médias et nos sociétés démocratiques, alertent les économistes Eric Heyer et Bruno Coquet.
En repensant la répartition des investissements publicitaires et en favorisant une dynamique plus équitable, il est possible de conjuguer innovation et préservation d’un écosystème médiatique diversifié. La relocalisation de la publicité est l’opportunité de construire un modèle plus vertueux pour l’économie française.
*L’association des Relocalisateurs œuvre en faveur de la relocalisation des médias, véritable enjeu d’emploi, de pouvoir d’achat et de défense de la démocratie. Leur mission est de promouvoir l’ensemble des médias nationaux et locaux pour développer la dynamique économique, sociale et démocratique des territoires.